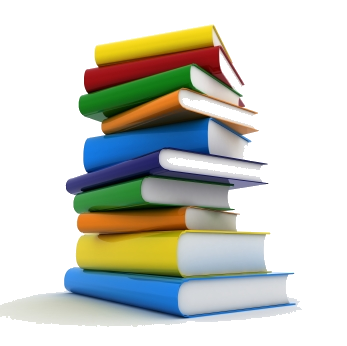Les dirigeants mondiaux se sont engagés à mettre fin à la pauvreté d’ici 2030. Mais, à moins d’investir pour ouvrir des perspectives aux enfants, en 2030, 167 millions d’enfants vivront dans une pauvreté extrême.
Shampa veut devenir banquière quand elle sera grande. Elle étudie le commerce à l’école et c’est sa matière la plus forte. Mais elle s’inquiète de ne pas pouvoir réaliser son rêve. Il y a moins d’un an, son père, journalier et principal soutien de famille, a eu un accident qui l’a laissé invalide et qui a transformé la vie de Shampa.
Comme la famille de Shampa a été fortement ébranlée par la catastrophe, la jeune fille est allée vivre avec sa tante, qui avait une solution : marier Shampa, alors âgée de 15 ans.
« Baba et Ma ne pouvaient plus payer mon éducation, explique-t-elle entre deux larmes. Ils ont pensé qu’une bouche de moins à nourrir les aiderait. »
Shampa a refusé de coopérer. Résolue à finir ses études, elle a obtenu l’appui d’un club local d’adolescents, un groupe de jeunes militants qui demande des comptes au gouvernement et exige la fin des mariages précoces. Tout ce que Shampa avait à faire, c’était de se manifester, et le groupe s’est aussitôt mis à l’œuvre.
Un petit détachement de sept jeunes s’est présenté sur le seuil de la maisonnette à deux chambres en bambou de la famille pour faire prendre conscience à ses parents des risques du mariage précoce. Ils leur ont expliqué que les grossesses précoces sont associées à un taux de mortalité plus élevé, tant pour la mère que pour l’enfant, et que Shampa serait forcée de consacrer ses journées à des tâches ménagères qui l’empêcheraient de finir ses études. Ils leur ont démontré que si Shampa finissait ses études, elle serait mieux à même de gagner de l’argent et de subvenir aux besoins de sa famille à l’avenir. Enfin, et c’est là l’argument qui a le plus porté, pense Shampa, ils leur ont rappelé que le mariage est illégal avant 18 ans au Bangladesh, et que cette loi est appliquée
« Le projet de sa tante a finalement échoué. Pourtant, l’expérience a ébranlé Shampa. « J’ai encore peur aujourd’hui, quand je me rappelle cette époque. »
Les parents de Shampa se sont engagés à subvenir à ses besoins jusqu’à la fin de l’année scolaire, pour qu’elle puisse obtenir son diplôme d’études secondaires, décerné à la fin de la 10e année. Mais ils ont fait valoir qu’ils ne pourraient plus financer ses études au-delà de cette date.
Si l’école primaire est gratuite au Bangladesh, les frais non officiels s’accumulent au secondaire. Le tutorat de groupe avant et après l’école est très répandu, et la plupart des élèves le considèrent comme la clé du succès. Outre les manuels scolaires, les élèves doivent acquérir des guides d’études additionnels, que l’école ne fournit pas. Et pour les plus pauvres, fréquenter l’école vient au prix de revenus de travail perdus.
Shampa espère qu’elle aura le choix de travailler, plutôt que de se marier. « Si j’étais un garçon, je ne pense pas qu’ils auraient songé à me marier... J’aurais travaillé et aidé ma famille. » Mais les filles n’ont pas beaucoup d’options : « Les tâches ménagères sont souvent le seul travail qu’on leur confie. »
Au-delà des dépenses associées à la fréquentation de l’école secondaire, les enfants des régions rurales éloignées doivent surmonter l’obstacle de la distance importante qui les sépare de l’école. Comme il y a moins d’écoles secondaires que primaires, les adolescents doivent souvent voyager loin de leur village et de leur communauté pour fréquenter l’école. Certains parents préfèrent ne pas risquer d’envoyer leurs filles à l’école, car ils s’inquiètent du harcèlement dont elles pourraient faire l’objet en route.
La pauvreté ne concerne pas que l’argent
En 2012, près de 900 millions de personnes ont peiné à survivre avec moins de 1,90 dollar américain par jour, soit le seuil international de pauvreté extrême. Plus de trois milliards de personnes restent vulnérables à la pauvreté, car ils vivent avec moins de 5 dollars américains par jour. Tout comme Shampa, ils ne sont jamais loin du bord du précipice, à une maladie près, à une sécheresse près, à une infortune près de tomber dans la pauvreté extrême.
Pour les enfants et les adolescents, la pauvreté n’est pas qu’une affaire d’argent. Ils vivent cette condition sous la forme de privations affectant divers aspects de leur vie, y compris la chance d’aller à l’école, de bien se nourrir et d’avoir accès à des soins de santé, à de l’eau potable et à des installations sanitaires.
Considérées dans leur ensemble, ces privations mettent fin prématurément à l’enfance de millions de jeunes, leur volant des pans entiers de ce qui caractérise cet âge de la vie : le jeu, le rire, la croissance et l’apprentissage. Ces perspectives fondamentales forment l’assise de leur avenir. Pour ceux et celles qui peuvent en profiter, le monde est plein de possibilités. Mais pour un enfant comme Arieful Islam, qui est déscolarisé parce qu’il doit travailler pour payer son repas quotidien, même les rêves sont hors de portée.
Arieful n’a jamais eu la chance de penser à ce qu’il veut devenir quand il sera grand. À 12 ans, il travaillait déjà depuis plus longtemps qu’il pouvait s’en souvenir, d’abord dans le domaine de la pêche, en 1re année, puis comme apprenti chez un fabricant de briques, du travail non rémunéré, mais qui lui fournissait tout de même un repas. Aujourd’hui, il travaille dans une usine de briques avec une bonne partie de sa famille. Pendant la basse saison, sa mère emprunte de l’argent du propriétaire de l’usine pour pouvoir survivre jusqu’à la fin de l’année. Toute la famille travaille ensuite pour rembourser ce prêt la saison suivante.
Arieful, qui n’a pas eu la chance d’aller à l’école quand il était petit, est à présent inscrit dans un programme de seconde chance qui se donne le soir. Il reçoit ainsi une petite bourse, mais pas assez pour compenser la perte du salaire quotidien de 3 dollars américains qu’il gagne en travaillant à l’usine de briques. Pendant la saison de fabrication de briques, il fréquente donc l’école par intermittence.
Comme les enfants vivent la pauvreté de multiples façons, se contenter de fournir des services (soins de santé et éducation, par exemple) ne suffit pas pour leur donner une chance équitable. Même si l’éducation est gratuite, un enfant comme Shampa pourrait être incapable d’assumer le coût des fournitures scolaires ou du transport jusqu’à l’école, et un enfant comme Arieful pourrait ne pas être en mesure de manquer un jour de travail. Les enfants les plus désavantagés ont besoin de moyens pour accéder à ces services.
Les programmes de protection sociale comme les transferts de fonds sont l’un de ces moyens pour réduire la vulnérabilité des familles à la pauvreté et aux privations, les aidant ainsi à surmonter les obstacles qui empêchent leurs enfants d’accéder à ces services. De tels transferts assurent un revenu minimum qui peut aider les foyers les plus pauvres et les plus vulnérables à sortir de la destitution. Ils agissent comme une échelle pour sortir de la pauvreté et ouvrent l’accès aux services, comme l’éducation, qui sont essentiels à l’avenir d’un enfant. Selon une estimation, les initiatives de protection sociale empêchent quelque 150 millions de personnes de tomber dans la pauvreté. Les transferts de fonds peuvent aussi contrôler quelques-uns des facteurs qui empêchent les enfants d’aller à l’école ou les forcent à abandonner leurs études.

Briser le cercle vicieux
Jhuma Akhter, âgée de 14 ans, est de retour à l’école, grâce à un programme de transferts de fonds. Et c’est une première de classe. Y arriver n’a pourtant pas été facile.
Lorsque Jhuma n’avait que 8 ans, elle a quitté l’école pour devenir domestique dans une famille où on l’exploitait. Elle y a passé trois ans, sans jamais être payée pour son travail ou pouvoir fréquenter l’école. Elle travaillait en échange de ses frais d’entretien et de la promesse faite par l’employeur de payer sa dot, lorsque viendrait le temps de se marier.
Finalement, la mère de Jhuma lui a permis de rentrer à la maison. Mais chaque jour, après l’école, Jhuma devait faire du porte-à-porte pour quémander du riz. Un soir, tandis qu’elles mangeaient leur riz sur le seuil de leur cabane au toit de tôle, Jhuma a expliqué à sa mère qu’à mesure qu’elle avançait dans ses études, les frais scolaires augmenteraient. Elle aurait besoin de tutorat, de guides d’études et de cahiers que l’école ne fournit pas. Sa mère a donc décidé qu’il ne valait plus la peine de l’envoyer à l’école et l’a amenée avec elle au travail. En travaillant à temps plein comme porteuse d’eau pour les commerces locaux, Jhuma gagnait l’équivalent d’environ 7 dollars américains par mois.
C’est alors que Nazma, une bénévole de la communauté, l’a repérée. « Ils cherchent des enfants comme nous », explique Jhuma. Nazma a invité Jhuma et sa mère à quelques rencontres pour évaluer les besoins de la famille et les inscrire dans un programme de transferts de fonds, à condition que Jhuma fréquente l’école. À présent que sa mère reçoit deux paiements annuels correspondant à environ 150 dollars américains, Jhuma a repris l’école. Elle est en 7e année.
Dans le quartier, Jhuma n’est plus la petite porteuse d’eau. Elle est à présent reconnue pour sa nouvelle routine. Chaque soir après la prière, elle installe sa table pliante et sa chaise en plastique près de la décharge, au tournant de la route, pour faire ses devoirs à la lumière du réverbère. Toujours aussi débrouillarde, elle rédige ses devoirs au dos des affiches de candidats laissées par la dernière campagne électorale.
Aujourd’hui, quand Jhuma imagine son avenir, le mariage ne fait plus partie du cadre. Elle croit désormais que les jeunes filles devraient attendre au moins jusqu’à l’âge de 22 ans avant de se marier, bien au-delà de l’âge minimum de 18 ans fixé par la loi. Jhuma rêve plutôt de devenir médecin, un jour. « Je veux prodiguer des soins à tout le monde. »
Source : UNICEF
 FR
FR EN
EN AR
AR